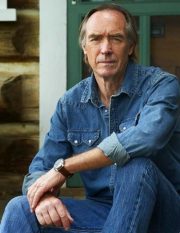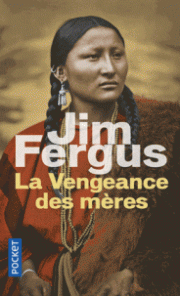« L’opinion américaine ignore tout de l’histoire et des conditions de vie des Indiens »
Seize ans après le succès de « Mille femmes blanches », l’auteur américain redonne vie à ses personnages de femmes fortes, envoyées dans l’Ouest par le gouvernement fédéral pour s’installer dans des tribus indiennes et ainsi faciliter l’intégration des Indiens à la société construite par les colons. L’expérience, racontée à travers le journal de May Dodd, avait cependant connu une fin tragique suite à la découverte de mines d’or en territoires indiens. Et les massacres avaient repris, n’épargnant ni les femmes ni les enfants métisses nés dans le cadre de ce programme.
« Mille femmes blanches » a connu un immense succès, en France comme à l’étranger. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour lui donner une suite ?
Avec « La Vengeance des mères », je n’ai pas voulu écrire une suite mais un roman à part entière, indépendant du premier. En littérature comme au cinéma, une suite est souvent moins réussie que l’épisode précédent et je ne voulais pas partir avec ce handicap, ni profiter d’un premier succès comme on exploite un filon. J’avais une quarantaine d’années quand j’ai écrit « Mille femmes blanches » ; j’en ai aujourd’hui soixante-six : ma sensibilité n’est plus la même, mon style a changé et je n’ai plus les mêmes préoccupations. La « Vengeance des mères » me semble de ce fait plus abouti que « Mille femmes blanches ». Certains lecteurs seront probablement déçus de ne pas retrouver le personnage de May Dodd, qui ne survit pas au massacre final, mais j’espère qu’ils apprécieront le retour des sœurs Kelly et seront heureux de rencontrer les nouveaux protagonistes comme Molly, le journaliste, et Pretty Nose.
C’est une photographie de Pretty Nose qui apparaît en couverture, n’est-ce pas ?
Oui, Pretty Nose est une figure historique des luttes indiennes, elle a combattu à Little Big Horn. Je tenais à ce que sa photographie soit la couverture de mon roman, car elle fut une source d’inspiration précieuse au moment de la rédaction. Regardez ses yeux : on peut y lire toute la force et la tristesse d’une femme qui se bat pour la survie de son peuple.
Vous adoptez souvent, dans vos romans, un point de vue féminin, notamment via le journal intime. Pourquoi ?
La première question fut celle de ma légitimité : en tant que Blanc, je ne pouvais pas adopter le point de vue d’un Indien, je n’en avais pas le droit. Les Indiens voient le monde à travers un prisme différent du nôtre, et même s’il commence à m’être familier, mes connaissances ne sont pas suffisantes pour parler en leur nom. Il fallait donc que j’adopte un point de vue « blanc ». Le choix d’héroïnes féminines et du journal intime est venu pendant mes recherches, qui s’appuyaient sur le récit de femmes qui ont tout quitté pour suivre leur mari à la conquête de l’Ouest, de ce qu’on appelle aux Etats-Unis la « Frontier ». Leurs journaux témoignaient de leur résistance, de leur abnégation face à des conditions de vie extrêmement difficiles, et leur force m’a nourri. Adopter la première personne me donnait en plus l’opportunité de me fondre dans mes personnages, de m’immerger dans leur quotidien et de le rendre plus tangible pour mon lecteur. En ce sens, la rédaction de « La Vengeance des mères » a été plus stimulante que celle de « Mille femmes blanches », car j’adopte ici le point de vue de plusieurs femmes et non plus uniquement celui de May Dodd.
Avec « La Vengeance des mères », il vous fallait à la fois satisfaire le lecteur de la première heure et ne pas décevoir un nouveau lecteur ignorant l’histoire de « Mille femmes blanches ». Comment vous y êtes-vous pris ?
Vous pointez là une difficulté majeure. Il était hors de question de répéter l’histoire de « Mille femmes blanches », mais il me fallait donner des indices au nouveau lecteur pour qu’il comprenne de quoi il retournait. La solution est venue avec les personnages des sœurs Kelly essentiellement, qui expliquent, par petites touches, ce qui est arrivé au nouveau convoi de femmes dont elles ont la charge. Comme elles ne veulent pas les effrayer, elles ne leur racontent pas tout d’un bloc, ce qui me permettait de disséminer des indices tout au long du roman. D’autres personnages, dont le destin était resté en suspens, ressurgissent également, comme Gerthie, Martha ou encore Jules Seminole. L’ensemble m’a permis de trouver le bon équilibre et, je l’espère, de satisfaire l’ensemble de mes lecteurs. Rien ne m’est plus précieux que d’entendre des personnes me dire que « La Vengeance des mères » leur a donné envie de se plonger dans « Mille femmes blanches » !
Dans « Mille femmes blanches », il était question de l’intégration des Indiens à la société construite par l’homme blanc. Ici, il s’agit plutôt d’extermination. Pourtant, le récit s’accompagne d’une célébration de la vie et des choses simples. L’avez-vous écrit dans cet esprit ?
C’est la teinte que j’ai voulu donner à cette histoire. Je ne voulais pas finir ce roman sur une note sombre, en dépit du caractère désespéré de la lutte des Indiens pour leur survie, raison pour laquelle « La Vengeance des mères » s’achève à Little Big Horn (remportée en 1876 par les Indiens contre les troupes du lieutenant-colonel Custer). Ces femmes au passé souvent douloureux comprennent qu’elles n’ont pas d’autre choix que de s’adapter à leur nouvelle vie, qu’elles ne doivent pas laisser passer cette seconde chance. La société construite par l’homme blanc est morte pour elles, elles ne veulent pas y revenir car elles ont été victimes de ses lois et de l’omnipotence masculine. Même si l’issue de leur combat semble connue d’avance, elles sont prêtes à en découdre. Rien n’est plus fort que l’amour d’une mère pour son enfant, même si la mort vient les séparer.
Comment avez-vous travaillé ce roman ? Avez-vous repris des notes rédigées pour « Mille femmes blanches » ? Etiez-vous en contact avec des Indiens ?
Pour « Mille femmes blanches », j’avais passé quelques mois dans une réserve qui comprenait un musée. Un ami indien m’avait alors fait découvrir sa culture et permis de rencontrer quelques sages, mémoires vivantes des traditions indiennes. Pour le reste, j’ai beaucoup lu et me suis inspiré des documents que j’ai pu trouver.
« La Vengeance des mères » paraît au moment où une lutte oppose, aux Etats-Unis, les membres de la tribu sioux de Standing Rock, dans le Nord du Dakota, au gouvernement fédéral. Les premiers s’opposent au passage d’un oléoduc sur leur réserve, une terre qu’ils considèrent sacrée. Pensez-vous que la médiatisation de cette affaire peut changer quelque chose à la condition des Indiens aux Etats-Unis, à leur reconnaissance ?
J’ai bon espoir que la médiatisation de ce conflit attire l’attention sur le sort des Indiens, mais je demeure pessimiste car, aux Etats-Unis, la notion de « terre sacrée » ne vaut rien face à celle de « productivité », et l’opinion ignore tout de l’histoire et des conditions de vie de ce peuple. Depuis la parution de « Mille femmes blanches », je reçois régulièrement des lettres de mes compatriotes qui se disent choqués de la manière dont le gouvernement américain a exterminé les Indiens. Nous n’apprenons pas cela à l’école, alors que c’est un pan essentiel de l’histoire des Etats-Unis. De la côte Est à la côte Ouest, bien peu sont ceux qui se préoccupent du sort des Indiens et se posent la question de la dette que nous avons envers eux. Alors quand un lobby aussi puissant que celui du pétrole décide de construire un oléoduc, personne ne songe à l’en empêcher. Mais cette fois c’est différent, car plus de deux cent tribus sont rassemblées à Standing Rock et cela attire l’attention des médias. Il faut voir comment ces gens qui manifestent pacifiquement sont traités : on envoie l’armée, un enfant a même été mordu par un chien. Dans quel monde vivons-nous pour tolérer cela ?
La défense de l’environnement, la nature, jouent un rôle primordial dans votre œuvre, que l’on rapproche souvent du genre littéraire du nature writing. Etes-vous d’accord avec cela ?
Absolument, on peut même dire que tous mes livres appartiennent au nature writing. La nature est mon personnage principal et m’inspire chaque jour. Quand je suis aux Etats-Unis, je mène une vie paisible, entouré de mes amis et de mes chiens. Nous pratiquons la chasse mais, au fil des années, je tue de moins en moins d’animaux. Ce qui me plaît, c’est la posture du chasseur, silencieux, observateur, à l’affût du moindre son. Cela fait plus de vingt ans que je n’ai pas mis les pieds à New York, cette ville me rend claustrophobe et, fondamentalement, je ne suis pas un citadin. Paris est l’une des rares villes où je me sens bien, j’ai plaisir à y venir, notamment pour rencontrer mon public français !
Comme de nombreux auteurs américains, vous êtes plus connu en France qu’aux Etats-Unis. « La Vengeance des mères » paraît d’ailleurs en France avant d’être publié aux Etats-Unis. Qu’est-ce que signifie cette reconnaissance pour vous dont la mère était française ?
Elle m’importe beaucoup plus que celle de mon pays. A chaque fois que je viens à Paris, j’ai l’impression d’être quelqu’un d’autre : les gens me reconnaissent, ils viennent me parler, c’est étonnant ! Cette reconnaissance est d’autant plus précieuse que j’ai peu connu ma mère, qui s’est suicidée quand j’avais seize ans. Elle avait suivi mon père en Ohio mais elle ne nous parlait jamais de ses origines, que j’ai découvertes ensuite. Ce qui compte pour moi, c’est d’écrire de belles histoires et je suis heureux que le public français ait la curiosité de les découvrir alors qu’elles parlent de contrées lointaines.
Propos recueillis par Laëtitia Favro