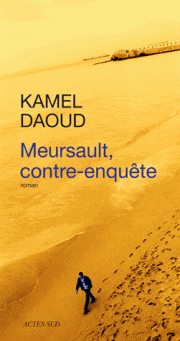|
La rédaction l'a lu
Duel littéraire au soleil: Moussa contre Meursault« Aujourd’hui, M’ma est encore vivante ». On entre dans le premier roman de Kamel Daoud par cet incipit qui provoque, et c’est bien normal, la curieuse impression du déjà lu. Car nous avons tous en mémoire l’une des premières phrases les plus célèbres de la littérature française qui ouvre « L’Étranger » de Camus : « Aujourd’hui, Maman est morte ». À travers cette entrée, comme par effraction camusienne, du roman « Meursault, contre-enquête », tout est dit de ce que propose avec une audace folle Kamel Daoud. Ce chroniqueur politique au quotidien d’Oran fait ses premiers pas en littérature en s’attaquant, ou pour être plus précis, en se mesurant à un livre sacré, véritable monument du 20ème siècle. Si l’entreprise n’était pas sans risque, le résultat est vertigineux. « Meursault contre-enquête » raconte la version de l’Arabe comme le dénomme Albert Camus, cette victime de Meursault, le célèbre meurtrier devenu héros littéraire. Cet assassin, on a tant parlé de lui qu’on en a presque oublié son crime et l’homme qu’il a tué. Si Camus ne lui a pas donné de nom, cela ne pouvait être que volontaire. C’est sur ce prénom « flottant dans l’angle mort du paysage » de « L’étranger » que Kamel Daoud va construire son roman pour relire cette histoire « réécrite, dans la même langue, mais de droite à gauche (…/…) Une histoire prise par la fin et qui remonte vers son début ». « Moussa, mon frère s’appelait Moussa ». C’est au frère de l’Arabe que l’auteur donne la parole un demi-siècle après les faits. Moussa Ouled El-Assasse. L’importance du nom que Camus, qui connaît la valeur des mots, n’a pas donné à cet homme, pauvre et illettré, assassiné de cinq balles dans le corps sur une plage déserte en 1942. Ne pas le nommer, c’est comme nier sa vie et refuser sa vérité. C’est le tuer une deuxième fois. Sur 150 pages, Haroun va redonner naissance à son frère disparu en révélant son identité perdue. Il donne un nom au mort comme on donne un nom au nouveau-né. Si Meursault a commis un crime, Haroun va lui aussi « commettre un livre », celui que nous, lecteurs, tenons entre nos mains et qu’il est impossible de lâcher. Dans ce roman, plus qu’une voix, c’est une colère contre l’injustice et l’oubli que l’on entend. Si celle de Meursault était une voix sublime, mais blanche, toute en retenue ciselée, « d’une froideur impossible dans un pays inondé de soleil et de figuiers », celle d’Haroun sous la plume de Daoud est dense, d’une générosité et d’une richesse propre à celui pour qui la langue, il y a peu de temps encore, était étrangère. Une langue française qu’il a récemment apprise pour survivre : « Une langue se boit et se parle, et un jour elle vous possède ». Et si dans le roman de Camus, Meursault est pétri de certitudes « j’avais eu raison, j’avais encore raison, j’avais toujours raison », Haroun lui, partage avec une profonde sincérité ses doutes et « redonne des angles aux choses ». Car avec cette enquête qu’il a menée, il est avant tout en quête d’identités. Celle de son frère qu’il a perdue, mais aussi la sienne et celle que son pays, depuis l’indépendance, essaye de retrouver. Pour Kamel Daoud, Camus a le génie de « décrire le monde comme s’il mourait à chaque instant. Comme s’il devait choisir les mots avec l’économie de sa respiration ». Et tout le talent de Daoud est de réussir à se mettre dans les pas du génie à travers sa voix à lui qui, au contraire, est nourrie d’un intense souffle de vie. C’est ainsi qu’il imprime sur ces pages, où raisonne la prose éclatante de Camus, ses propres traces comme des empreintes brûlantes. On oublie vite le jeu des comparaisons entre le chef d’œuvre et ce premier roman, tant ils se complètent et s’enrichissent. D’un côté un texte solaire et de l’autre un texte crépusculaire. Tous deux abordant les thèmes essentiels de la mère, de l’amour et de la mort. Lisez Daoud, relisez Camus comme ce que le jour doit à la nuit. Leur lecture simultanée, nous le souhaitons, sera désormais incontournable pour comprendre et accepter que dans toute histoire « tout est vrai et rien n’est vrai ». Tout dépend de qui la raconte.
Les internautes l'ont lu
coup de coeur
L’étranger revisité
L’an dernier j’avais lu l’adaptation BD de L’étranger par Ferrandez (un petit coup de coeur, mon avis est ici) et relu l’original de Camus. Je l’ai repris comme point de départ de cette lecture. Un livre court mais dense qui pousse à de nombreuses réflexions. L’écriture est sublime, riche et sobre à la fois. Haroun, le narrateur s’adresse à nous à la première personne, il est dans un bar et tutoie son interlocuteur. Il lui raconte l’histoire de la mort de son frère écrite par l’assassin, un certain Meursault qui doit sa liberté à sa plume. Il est clair que la référence est celle de l’oeuvre de Camus. Il nous raconte son point de vue comme dans un miroir. L’arabe cité à vingt-cinq reprises dans le livre, c’est son frère Moussa qui n’est pas nommé. Ce manque d’identité change TOUT. Haroun a sept ans lorsque son frère est tué, il sera victime vingt ans durant, jusqu’à sa vengeance en 1962, ce meurtre gratuit à l’aube de l’indépendance sera la réponse à sa frustration. Le récit est défendu avec beaucoup de verve, avec une langue magnifique qui nous amènera à beaucoup de réflexion. Daoud versus Camus, effet miroir : son héros Meursault/Moussa, les problèmes avec sa mère (son pays ?) , le meurtre gratuit, la solitude. Un bel hommage à la littérature française. Un roman sur la recherche de l’identité mais dans lequel il clame sa haine de la religion et l’aveuglement de son peuple dans le refuge de ce Dieu et de sa religion. Un récit primé à juste titre qui ne pourra vous laisser indifférent. Ma note : 9.5/10 Les jolies phrases Le premier savait raconter, au point qu’il a réussi à faire oublier son crime, alors que le second était un illettré que Dieu a créé uniquement, semble-t-il, pour qu’il reçoive une balle et retourne à la poussière, un anonyme qui n’a même pas eu le temps d’avoir un prénom. Quand les colons s’enfuient, ils nous laissent souvent trois choses : des os, des routes et des mots – ou des morts. Comme un vrai fils de veilleur de nuit, je dors peu et mal, aujourd’hui encore – je panique à l’idée de fermer les yeux pour tomber je ne sais où sans mon prénom en guise d’ancre. M’ma m’a transmis ses peurs et Moussa son cadavre. Que veux-tu qu’un adolescent fasse, ainsi piégé entre la mère et la mort ? Etrange histoire tout de même. C’est ton héros qui tue, c’est moi qui éprouve de la culpabilité, c’est moi qui suis condamné à l’errance. Toi, tu veux retrouver un cadavre, alors que moi je cherche à m’en débarrasser. … C’est un déni d’une violence choquante, tu ne trouves pas ? Dès que la balle est tirée, le meurtrier se détourne et se dirige vers un mystère qu’il estime plus digne d’intérêt que la vie de l’Arabe. Il continue son chemin, entre éblouissement et martyr. Mon frère Zoudj, lui, est discrètement retiré de la scène et entreposé je ne sais où. Ni vu ni connu, seulement tué. A croire que son corps a été caché par Dieu en personne ! Aucune trace dans les procès-verbaux des commissariats, lors du procès, dans le livre ou dans les cimetières. Rien. Arabe, je ne me suis jamais senti arabe, tu sais. C’est comme la négritude qui n’existe que par le regard du Blanc. Dans le quartier, dans notre monde, on était musulman, on avait un prénom, un visage et des habitudes. Point. Eux étaient « les étrangers », les roumis que Dieu avait fait venir pour nous mettre à l’épreuve, mais dont les heures étaient de toute façon comptées : ils partiraient un jour ou l’autre, c’était certain. J’ai toujours cette impression quand j’écoute réciter le Coran. J’ai le sentiment qu’il ne s’agit pas d’un livre mais d’une dispute entre le ciel et une créature! La religion pour moi est un transport collectif que je ne prends pas. J’aime aller vers ce Dieu, à pied s’il le faut, mais pas en voyage organisé. Les sentiments vieillissent lentement, moins vite que la peau. Quand on meurt à cent ans, on n’éprouve peut-être rien de plus que la peur, qui à six ans, nous saisissait lorsque, le soir, notre mère venait éteindre la lumière. C’est le génie de ton héros : décrire le monde comme s’il mourait à tout instant, comme s’il devait choisir les mots avec l’économie de sa respiration. La gratuité de la mort de Moussa était inadmissible. Or ma vengeance venait d’être frappée de la même nullité. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que quelqu’un pose une question sur l’existence de Dieu, il se tourne vers l’homme pour attendre la réponse. J’avais refroidi tous les corps de l’humanité en en tuant un seul. Retrouvez Nathalie sur son blog http://nathavh49.blogspot.be/2015/04/meursault-contre-enquete-kamel-daoud.html |
|
|
|
|
|