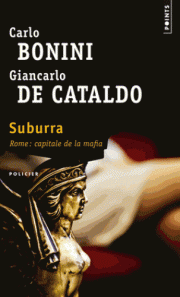« Le code moral est une pure invention »
Depuis dix ans et la parution de « Romanzo criminale », Giancarlo de Cataldo s’évertue à ce que jamais la mafia italienne ne puisse faire rêver. S’il concède aux chefs de clan une forme d’intelligence qui, sans l’excuser, donne du sens à leur sanglante dérive, il dépeint un monde fermé sur lui-même, où cruauté et cupidité, indissociables, étouffent toute autre aspiration, tout sentiment. Pour le sixième volet de sa saga mafieuse, « Suburra », le juge-écrivain romain a adossé son inspiration à celle du journaliste d’investigation Carlo Bonini. Ensemble, ils ont mis dans le mille. Anticipant un énorme scandale de corruption qui a trouvé son issue en novembre dans un procès retentissant… Montrant autour de leur patron, le Samouraï, des voyous infiniment plus « affreux, sales et méchants » que les pauvres du film d’Ettore Scola… Cernant l’isolement des quelques magistrats et policiers restés intègres face à la pieuvre… Si son adaptation au cinéma est expurgée de tout personnage positif, le roman oppose en effet à la résolution froide et cynique des criminels la foi et le courage d’un policier d’élite, d’un procureur et d’une blogueuse activiste. Face à l’alliance venimeuse des tueurs romains, napolitains, calabrais et gitans, face à la lâcheté des responsables politiques et policiers ayant vendu leur âme au diable, l’humanité du trio apparaît bien fragile. La peinture de cette nouvelle décadence romaine n’en est que plus dérangeante.
Avec « Suburra », publié en 2013 en Italie, vous avez en quelque sorte anticipé l’affaire dite « Mafia Capitale », qui vient tout juste d’être jugée à Rome…
Avec Carlo Bonini, nous avons commencé à réfléchir à ce livre fin 2011, pour l’écrire en 2012 et le sortir en septembre 2013… Carlo est un journaliste d’investigation qui connaît bien la réalité romaine, il m’a apporté beaucoup d’informations, et ensemble, on a compris qu’avant cette période, il s’était passé des choses entre la mafia et la droite affairiste, sous les yeux d’une gauche distraite. On a remarqué des changements dans le paysage urbain, de simples boutiques qui devenaient de grandes chaînes de magasins ou des restaurants où l’on flairait la présence de la pègre. Il y a eu ce député pris dans une orgie avec des jeunes femmes et de la cocaïne, et cet autre qui a conclu un accord avec le procureur pour rendre 300 millions d’euros… On a réuni tout cela sans savoir qu’il y avait une enquête. Quand on a écrit que Rome puait la Mafia, on nous a dit qu’on exagérait. Et puis quand l’enquête de la justice a été révélée, on nous a dit qu’on aurait pu aller beaucoup plus loin…
« Suburra » réunit une incroyable galerie de personnages. Y en a-t-il un qui se soit imposé à vous plus que les autres ?
On travaille sur des types humains qui deviennent des archétypes littéraires. Le chef de la pègre, c’est celui qui règle les conflits. Il n’est donc jamais jeune, car les jeunes tuent pour régler les problèmes. Le chef a une expérience de la pègre ancienne. Et comme dans la période 2011-2012, la droite était au pouvoir, quel personage ayant un passé d’extrême-droite a pu travailler comme entrepreneur ou gérer des contrats publics ? C’est comme cela qu’est venu l’idée du samouraï. Mais aucun chef mafieux n’a jamais utilisé, comme lui, de Katana pour tuer. Pas plus qu’il n’y a eu de trafic de cocaïne avec une mafia georgienne. Notre livre n’est pas une enquête et nous n’avons pas eu accès privilégié à des informations secrètes.
Vous avez donc tout déduit, tout imaginé ?
Des enquêtes journalistiques parues quelques mois avant ou après notre roman vont plus loin et donnent des noms. Mais nous, nous introduisons des éléments ou des scènes qui n’ont pas existé, le Dubaï Palace, la prostituée Sabrina, les fêtes… Dans la réalité, les invités de certaines fêtes mafieuses portaient des têtes de cochons en guise de masque et dînaient assis sur des WC en proclamant « Nous sommes dans la merde ! »… C’est moins raffiné que ce que nous décrivons.
Hormis leur chef, le Samouraï, les mafieux de « Suburra » apparaissent tous incroyablement stupides. Vous avez forcé le trait ?
Ce n’est pas la réalité romaine, mais c’est celle de la criminalité en général. Le jeune criminel est très violent. Et la loi du milieu est de se montrer sans pitié, cruel, de faire peur aux autres. Si on veut devenir chef, il faut prendre ses distances avec la rue et devenir bourgeois. Un criminel bourgeois peut travailler ses relations, ses réseaux, et se maintenir sans violence, sans morts. La menace de la violence lui suffit. La respectabilité criminelle implique que tu peux tenir ta parole sans avoir à tirer. Par chance – pour nous – quand un criminel s’embourgeoise, un jeune arrive qui a plus faim et prend son poste. La chance, c’est qu’ils n’ont pas compris cette règle du jeu…
Comment faire en sorte que le Samouraï ne soit pas trop fascinant ?
Dans « Romanzo criminale », les personnages de bandits sont fascinants. Ici, ils sont affreux, sales et méchants. Même celui qu’on appelle « Numéro 8 » est glacial. La technique consiste à donner à chacun sa propre voix, ses propres pensées, sa propre originalité, tout en taisant celle de l’auteur. Le Samouraï apparaît tel qu’il se perçoit, tel qu’il se raconte. Mais la littérature criminelle consiste de toute façon à rendre les méchants fascinants. Il faut juste que les bons ne soient pas fades. Notre Samouraï a quelque chose de celui que jouait Alain Delon dans le film de Jean-Pierre Melville. C’est un tueur avec un code moral. Sinon que le code moral est une pure invention.
Votre roman met en cause un homme d’église, des élus, des magistrats, des policiers, tous vendus à la Mafia… Vous avez dû en fâcher quelques-uns…
On s’est fait beaucoup d’ennemis, c’est vrai. Peut-être que je devrais plutôt écrire des histoires de commissaires qui aiment la bonne cuisine et enquêtent sur des délits commis par des notables ? Mais tout ce que nous racontons vient des rubriques de faits divers : un prêtre arrêté pour avoir volé, des responsables politiques qui concluent un accord avec la justice pour rendre de l’argent détourné, des policiers corrompus mis en examen, des magistrats virés… Cela ne veut pas dire que dans la réalité tous sont des saints, ni que tous sont corrompus. C’est une question de dosage. Si l’on collait trop à la réalité, l’histoire ne serait pas jolie-jolie à regarder.
Qu’avez-vos pensé du film tiré de votre livre ?
Magnifique, mais très différent. Nous avons collaboré au scénario, mais c’est le film de Stefano Sollima. Il a choisi de n’adapter que la guerre entre les Anacleti et Numero 8, autour du projet immobilier Waterfront à Ostie. Ce n’est pas notre roman. Il y a aussi en projet une série produite par Netflix avec la participation de la RAI, qui en est au stade du synopsis. Je suis impliqué, là aussi, car j’ai une nature de père anxieux et je veux m’en mêler.
« Suburra » est votre deuxième livre écrit à quatre mains. Qu’est-ce que cela change, de travailler à deux ?
Il faut être amis, avoir un plan commun et la même idée de l’écriture. On se partage les personnages, j’écris une partie, Carlo une autre, on échange pour se corriger mutuellement et, ensuite, je révise tout le texte, notamment pour harmoniser la langue. A la fin, on lit tout le texte ensemble, à haute voix. Mais ma première lectrice, c’est ma femme. Et elle est dure avec moi. Si c’est bon, elle dit : « C’est bon ». Mais si ça ne lui plaît pas, c’est: « Mais qu’est-ce que tu as écrit là ? » Alors, je m’énerve, j’invoque les tendances littéraires du moment, les critiques allemands, les auteurs américains ou les lecteurs français. Mais elle ne bouge pas : « Ça n’est pas bon ». Elle a raison dans 99% des cas. Elle exerce un contrôle très fort sur les personnages féminins, elle est persuadée que nous n’avons pas la sensibilité pour comprendre l’âme des femmes. Pourtant, les femmes fortes, je sais ce que c’est : j’en ai épousé une !