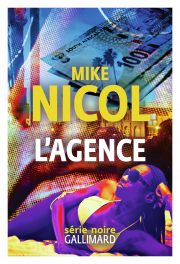r e n c o n t r e a v e c
Mike Nicol
« Le système va péter un jour. On ne sait juste pas quand. »
Mike Nicol voit son Afrique du Sud comme un pays à la dérive. A la différence de son collègue et ami Deon Meyer, qui s’attache à montrer des policiers noirs et blancs œuvrant ensemble à faire régner la justice, lui décrit un régime toujours plongé dans le chaos. « L’Agence » qui donne son titre à son dernier livre est le tentaculaire service de renseignement national – bien réel – qui déploie ses agents sur le territoire et à l’étranger pour couvrir un complot, des pillages et des crimes fomentés dans l’entourage du président. Une machine de mort et de manipulation. L’ex-journaliste qu’est l’auteur n’a rien inventé, il dresse l’état des lieux des années où Jacob Zuma était au pouvoir. Et rien ne semble réglé depuis sa démission début 2018. Seul point positif, cette déliquescence apporte à Mike Nicol un flot de bonnes histoires à raconter.
A vous lire, le projet de « nation arc-en-ciel » que promettait Desmond Tutu est bel et bien enterré…
Pour être honnête, je n’y ai jamais cru. Mandela a été un bon président, mais à l’international. A l’intérieur, c’est son vice-président, Thabo Mbeki, qui a dirigé le pays. La transition de l’apartheid à la démocratie a été magique, le monde entier nous adorait, tout semblait possible. Et du coup, les écrivains n’avaient plus de sujet, plus rien à dire : je me souviens avoir jeté un manuscrit que j’avais commencé en 1995. Les couleurs et le ton de notre politique ont changé quand Mbeki a pris la suite de Mandela. Il était fou : il niait le lien entre HIV et Sida, il refusait la mise en vente d’anti-rétrovirus. Il est responsable de dizaines de milliers de morts, il aurait fallu le juger pour génocide. Il a simplement démissionné à la suite d’un putsch interne au parti. Après un intérim de 18 mois, Jacob Zuma a pris la suite. Il avait déjà été jugé pour viol et acquitté. Notre violeur devenu président s’est mis à systématiquement voler l’argent du pays. Ivre de pouvoir, il a tout détruit en dix ans. Il faudra des générations pour tout réparer…
Etes-vous un auteur de polar passionné par la politique ou un journaliste pris au jeu du polar ?
Un peu des deux. Un Sud-Africain né dans les années 1950, comme moi, est forcément un animal politique. Si en plus, son métier est d’écrire, la politique s’impose encore plus à lui. Le journalisme m’a permis d’assister à tout cela aux premières loges et le roman policier d’en faire des histoires accessibles, faciles à lire.
Vous n’êtes pas le seul…
Dans les années 2008 à 2015, les auteurs de polars écrivant en anglais étaient nombreux. Ça s’est arrêté en 2015 et depuis, je suis à peu près le seul. Deon Meyer, lui, écrit en afrikaans et il est traduit en anglais, ce qui lui vaut son succès international. Mais ses livres sont moins politiques et plus optimistes. Pour moi, la police sud-africaine reste l’ennemi, comme sous l’apartheid. Je ne pourrais pas écrire comme lui d’enquêtes policières où le flic gagne à la fin.
Comme anglophone, il reste Roger Smith…
Roger est marié à une métisse dont la famille est très liée aux gangs du Cap. Lui et sa femme craignaient pour la sécurité de leur enfant et ils sont partis vivre en Thaïlande. Il écrit toujours, mais de la science-fiction.
On peut donc, comme eux, avoir peur d’élever ses enfants en Afrique du Sud ?
En ce qui me concerne, je ne bougerai plus de là-bas mais quand ma petite-fille, qui a 10 ans, aura terminé ses études, je lui dirai de partir. J’ai cinq neveux et deux nièces, ils ont tous quitté le pays. Mes ancêtres ont immigré du Royaume-Uni en 1820 mais d’ici à 2050, une fois que ma sœur, mon frère et moi nous ne serons plus là, il n’y aura plus trace de notre famille en Afrique du Sud.
Comment vous est venue d’idée du jeune couple de héros de « L’Agence » ?
Ayant moi-même fait beaucoup de surf, j’aimais cette idée d’un détective privé blond et surfeur comme Fish Pescado. Quant à Vicky Kahn, je la voyais métisse et surdiplômée. En les associant, je me donnais deux moyens d’accéder à la vérité : lui de l’extérieur, par l’enquête, elle de l’intérieur, grâce à son métier d’avocate, puis d’espionne. Ils ont une petite trentaine et ont donc peu vécu sous l’apartheid, c’est naturel pour eux d’aller à la plage ensemble par exemple. Moi j’ai connu cette période où blancs, métis et noirs étaient séparés.
On va les revoir ?
C’est bien commode, une série avec des personnages récurrents, c’est comme enfiler un vieux pull. Et ils me permettent d’analyser la société. J’ai publié un troisième roman avec eux et je viens d’en terminer un quatrième (« L’Agence » faisait déjà suite à «Du sang sur l’arc-en-ciel » NDLR ).
Le service de renseignement sud-africain, « L’Agence », est-il tel que vous le décrivez ?
Oui, c’ est un vrai bazar et ce que j’en montre est même plutôt adouci. Il y a longtemps eu deux services, un pour l’extérieur et un pour l’intérieur, mais Zuma les a fusionnés en un seul. Le problème est qu’il échappe à tout contrôle politique. Le président peut s’en servir pour rendre la vie infernale à ceux qu’il n’aime pas et Zuma ne s’en est pas privé. C’est contraire à notre constitution mais comme l’ANC (parti au pouvoir, issu du mouvement clandestin de Mandela NDLR) a la main sur le Parlement, on n’y peut rien. Toute ma vie, j’aurai connu une démocratie à parti unique.
Ça ne va pas mieux depuis la démission de Zuma, début 2018 ?
On a cru ça les six premiers mois. Cyril Ramaphosa, notre nouveau président, est un juriste, il veut faire les choses dans l’ordre. On a donc une foule de commissions qui enquêtent sur la corruption. On connaît les noms des escrocs, mais personne n’est poursuivi et jugé. Il attend, il n’affirme pas son autorité. En fait, le comité qui dirige le parti est coupé en deux et il est bloqué. Rien n’avance. C’est dramatique. Le taux de chômage officiel est de 32% et l’officieux de 42%. La majorité des sans emploi ont de 19 à 30 ans. Et sur 60 millions d’habitants, 19 millions vivent des aides sociales et 5 millions seulement paient des impôts, la classe moyenne. Notre électricité est plus chère qu’à New York, alors qu’on avait la moins chère du monde avant Zuma, et chaque foyer a droit à deux heures de courant par jour, suivant un horaire tournant. Avec la sécheresse en plus, il va falloir que j’investisse dans un puits et des panneaux solaires pour avoir l’eau courante et pouvoir la chauffer. Et je suis un blanc qui vit dans un quartier de blancs. Imaginez ce que cela donne dans les « townships » (quartiers noirs de banlieue NDLR). Le système va péter un jour. On ne sait juste pas quand.
Quelle est la situation au Cap, où vous vivez ?
C’est devenu la pire ville d’Afrique du Sud en termes de criminalité. On vit comme au temps de l’apartheid, avec des quartiers pour les blancs et d’autres pour les non-blancs, comme les Cape Flats où la guerre des gangs peut faire une dizaine de morts en un week-end. La où j’habite, on peut sortir dans la rue sans risquer de prendre une balle mais si je veux rendre visite à Deon (Meyer), par exemple, je risque de tomber sur une rue ou un quartier en pleine émeute, avec des jets de pierres et des pneus qui brûlent. En dix ans, c’est devenu l’enfer.
Pourquoi ?
L’argent qui aurait dû aller dans les hôpitaux, les écoles, les transports, les emplois a quitté le pays sous Jacob Zuma. Les réseaux de routes, d’électricité, d’eau, d’égouts n’ont plus été entretenus, notamment dans les townships. Vous en arrivez aussi à cette violence xénophobe où des noirs sud-africains s’en prennent à d’autres noirs immigrés d’Afrique centrale qui s’en sortent mieux qu’eux.
Les médias en parlent ?
Je ne lis plus les journaux car je n’ai plus confiance. On a heureusement des sites web d’information dont on ne peut plus se passer, comme le Daily Maverick ou le Mail & Guardian, qui fait un travail d’enquête extraordinaire. Le pire, c’est que leurs révélations n’ont aucune suite judiciaire et donc que les responsables politiques s’en moquent et leur fichent la paix. Sous l’apartheid, un article qui déplaisait pouvait vous valoir 120 jours de détention. Sans compter la surveillance : j’ai été journaliste dans un magazine de gauche, mon téléphone était écouté, j’entendais un « clic » quand je décrochais. Il fallait faire avec.
Vous n’êtes plus journaliste ?
Je travaille comme formateur. Je donne des cours en ligne, écriture créative et écriture d’essais, et j’ai créé avec une collègue une masterclass sur l’écriture de fiction. C’est très satisfaisant sur le plan financier et c’est une réussite puisque plusieurs de nos élèves ont déjà publié leurs premiers livres. Tant qu’on a de l’électricité et un accès à Internet, j’ai de quoi vivre.
Les ventes de livres ne suffisent pas ?
En Afrique du Sud, mieux vaut écrire en langue afrikaans. Deon Meyer doit vendre 20.000 à 30.000 exemplaires dans sa langue, plus 15.000 à 20.000 en anglais. Il peut en vivre. Mon éditeur a choisi trois de mes livres pour les traduire en afrikaans, vu que le marché est plus gros, ils ne se sont pas vendus. Pourquoi ? Parce que les quelques afrikaans intéressés sont capables de me lire en anglais.
Vous êtes lu en Europe…
Au Royaume-Uni, pas trop, je suis trop étranger pour eux. Les Britanniques ne sont pas des lecteurs très audacieux et ils voient le polar comme une littérature bas-de-gamme. A la rigueur, ils veulent bien des enquêtes policières classiques mais de chez eux. Même Deon Meyer a du mal. Ailleurs en Europe, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas… les lecteurs sont plus ouverts. Ce sont d’ailleurs surtout des femmes et leur niveau de tolérance aux histoires violentes me surprend toujours. Même si, pour ma part, venant d’une société hyperviolente, je considère qu’on peut en parler sans trop la montrer, sans trop la décrire.
Propos recueillis par Philippe Lemaire
Notre critique de « L’Agence » est ici