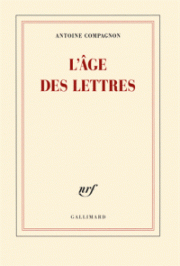Le livre de Compagnon est arrivé un peu tard sur ma table, raison pour laquelle je ne l’ai pas mentionné dans mon dernier billet. Et pourtant, c’est le livre que j’attendais. Une évocation émouvante, sensible de ce que furent Barthes et le groupe qui gravitait autour de lui, une plongée pleine de délicatesse et d’humour, de tendresse et de lucidité dans ce que furent les dernières années de Barthes .
L’Age des lettres fourmille de notations inattendues sur les bêtises que peuvent dire les plus intelligents de nos intellectuels, leur goût pour les histoires idiotes ; sur cette façon qu’avait Barthes de ne plus vraiment écouter ce qui se passait autour de lui, de s’absenter dans on ne savait quelle rêverie ; cette manie, pas forcément agréable, de ne jamais se séparer d’un petit carnet à spirales dans lequel il notait des bribes d’idées, comme s’il craignait qu’elles soient trop fugaces pour qu’il puisse les retrouver, bien rangées, à leur place, dans sa tête. » La méthode de travail qu’il avait mise au point [ était la suivante] il prenait tout le temps des notes dans son carnet ; remonté chez lui, il reportait ses notes sur des fiches ; il classait et reclassait ses fiches jusqu’à trouver le bon ordre ; puis il rédigeait son manuscrit autour de ses fiches. »
De manière surprenante, Compagnon raconte que tout un pan de la vie de Barthes, en dépit de l’intimité qui fut la leur, lui demeure parfaitement inconnu et qu’il ne le découvre qu’à la parution des Fragments d’un discours amoureux – son côté dragueur impénitent toujours à l’affût. Du coup, la nature des relations qu’il entretient avec lui reste incroyablement floue : amitié passionnée ? amitié amoureuse ? En tout cas, relation privilégiée dont Compagnon sait dire l’intensité.
Et le Barthes qu’il évoque est extraordinairement vivant ; « Roland vidant son assiette comme un affamé, dévorant avec les doigts ; Roland palpant son cigare, le faisant rouler entre le pouce, l’index et le majeur, tandis qu’il l’allume lentement, tranquillement avec une longue allumette, tout absorbé par le rituel, silencieux ; Roland au volant de sa Volkswagen rouge entre Bayonne et Urt, Roland au Palace, pas du tout à sa place, accablé par le bruit, mais curieux, poli ; Roland au piano, dans le petit appartement de la rue Servandoni, simple, monacal ; Roland à la sortie du théâtre Récamier, regardant la caméra de côté ; Roland Oisif, désoeuvré, au milieu de son cours au Collège de France, les yeux en l’air, en attendant que les auditeurs aient fini de retourner leur microcassette, se demandant ce qu’il fait là. »
Il n’hésite pas à se mettre lui-même gentiment en boîte, reconnaissant qu’il n’a pas toujours été à la hauteur de ce que Barthes attendait de lui, lors de ce Colloque de Cerisy dont il assure, à la demande de Barthes, la direction sans avoir la moindre expérience de ce petit monde littéraire et des frictions inévitables, des susceptibilités froissées, des jalousies plus ou moins rancies qui le caractérisent. Et qu’il peut y avoir dans l’orientation qu’il donna à sa carrière comme une trahison de ce qu’il a pu apprendre au contact de Barthes. Et surtout avouant que, s’il a aimé Barthes, il n’a pas forcément aimé tous ses livres.
Retrouvez Patrick Rödel sur son blog