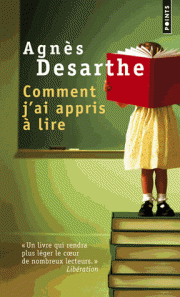C’est un très étrange, intense et émouvant nouveau livre que signe aujourd’hui Agnès Desarthe. La romancière prolifique, qui avait eu le Prix du livre Inter dès son deuxième roman, « Un secret sans importance » en 1996, a depuis poursuivi une œuvre personnelle faite de textes qui tiennent sur un fil et dont on n’oublie pas les personnages, ainsi le narrateur d’ « Une partie de chasse », son dernier livre sorti chez L’Olivier en 2012. Elle est également auteur de littérature jeunesse et traductrice, notamment de Virginia Woolf et Cynthia Ozick. Avec « Comment j’ai appris à lire », Agnès Desarthe réfléchit à sa relation à la lecture, ou plus exactement à la littérature, relation qui, nous dit-elle de façon extrêmement surprenante, avait mal commencé.
Quand d’aucuns se vantent d’avoir lu tout Proust à douze ans, Agnès Desarthe confie avoir longtemps prétendu ne pas aimer lire, et opposé une résistance opiniâtre aux textes imposés par l’institution scolaire, alors même qu’elle a été une excellente élève depuis la petite école jusqu’à Normale sup. Mais elle nous prévient en guise de prologue : « Apprendre à lire a été pour moi une des choses les plus faciles et les plus difficiles. Cela s’est passé très vite, en quelques semaines ; mais aussi très lentement, sur plusieurs décennies.
Déchiffrer une suite de lettres, la traduire en sons fut un jeu. Comprendre à quoi cela servait fut une traversée souvent âpre et, jusqu’à l’écriture de ce livre, profondément énigmatique ».
Comme on se lance dans une psychanalyse, Agnès Desarthe déroule patiemment l’écheveau. La petite enfance, les premières années d’école, l’apprentissage de la lecture, puis le lycée, khâgne, l’écriture, mais aussi le grand-père maternel né en Russie, absent de la photo de famille parce que mort en déportation, la grand-mère paternelle analphabète, venue de Lybie. Des figures déjà évoquées dans un de précédent livre autobiographique, « Le remplaçant », (L’Olivier 2009) apparaissent. Agnès Desarthe s’interroge, rassemble des souvenirs, des anecdotes susceptibles de l’éclairer. Sa fascination pour l’écriture, le stylo qu’on tient dans la main, alors qu’elle est toute petite. Sa passion des calembours, son imagination débordante qui lui fait préférer le « vrai faux » au « faux vrai », les Castors juniors au Club des cinq, dont les enfants parfaits l’horripilent. Agnès Desarthe se souvient aussi de ses débuts à l’école primaire, sur lesquels elle revient plusieurs fois, déchiffrant aujourd’hui un événement fondamental qui, à l’époque, n’avait pas été relevé : sans qu’on lui explique pourquoi, elle a été scolarisée dans une école de garçons, avec quelques autres très rares petites filles. Agnès Desarthe analyse en outre son travail de traductrice. Enfin, elle scrute des sensations qu’elle ne parvient, au premier abord, à relier à rien. Par exemple, dans un de ses romans pour enfants, une petite fille avoue en chuchotant : « Je lis en cachette de moi-même ».
« Chaque fois que je tombe sur cette réplique, les larmes me montent aux yeux sans que je puisse le prévoir, souligne Agnès Desarthe. La ligne d’avant, ils étaient secs, à celle d’après, je me demande ce qui m’a pris. […] Disons que l’émotion qui m’envahit à l’instant où je lis cette phrase est une émotion réflexe. Je n’y suis pour rien. Point de madeleine à émietter ici. Plutôt un caillou dur, opaque, comme sont les chagrins de l’enfance, si bien refermés sur eux-mêmes ».
Ainsi, peu à peu, le puzzle se met en place.
« Alors que je suis une enfant sage, gâtée, heureuse, j’ai la sensation que le monde qui m’entoure est chaotique. Je n’en dis rien. Je fonctionne remarquablement. Je réponds à toutes les attentes. Je suis bonne élève […]. Je me méfie, cependant, de ce que j’appelle aujourd’hui le premier degré de la vie ».
Certes, on ne fait pas le tour d’une vie en un livre. Mais Agnès Desarthe approche ici quelque chose d’essentiel, et son propos touche à l’universel : nous sommes fondamentalement des êtres de langage. Notre relation à la langue, l’écriture, la lecture, est porteuse de tout ce qui nous a fait. Elle traduit nos failles, souffrances, traumatismes, même ceux que nous ne soupçonnons pas. Un pays d’origine mystérieux, un grand-père disparu dans une horreur innommable, une langue que le père possède mais à laquelle la petite fille ne comprend rien. Et une école primaire inexplicablement remplie de garçons.
Ce livre fera date, pas seulement par l’émotion qui s’en dégage. Mieux qu’une thèse de quatre cents pages, il aborde avec justesse un thème encore peu étudié : la relation riche et complexe qu’entretiennent avec leur langue des écrivains français nés dans des familles issues de l’exil ou de l’immigration. Et l’imagination débordante qui dans certains cas semble être un moyen de survie.
Lire l’interview : Quelle lectrice êtes-vous Agnès Desarthe ?