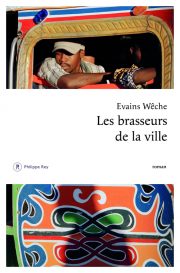|
Les internautes l'ont lu
coup de coeur
Saisissant
Un premier roman saisissant, hors des sentiers battus, l’auteur nous conte l’histoire d’une famille à Haïti. La narration est à deux voix, celle des parents de 5 enfants, deux filles Babette, Lizzie et 3 garçons Alcéhomme, Jonathan, Yvon. La mère vend des serviettes sur le marché, fait des petits boulots, se prostitue pour nourrir la famille. Le père travaille dans le bâtiment et cumule aussi les heures pour réussir à ramener un peu de nourriture à sa famille. C’est le récit de la misère, de la désespérance, de la débrouille qui nous est conté par l’auteur. Ce pays tentaculaire comparé à un mendiant, une prostituée qui ne survit que par perfusion des aides internationales, de l’ONU. La corruption, la violence, la misère des bidonvilles est décrite de manière très précise. La femme est vue comme un objet, une personne débrouillarde qui utilise son corps pour assurer leur subsistance. En espérant la rencontre avec un étranger, un fonctionnaire ou un homme marié qui l’entretiendra elle et sa famille. La faim quotidienne, les transports en commun inexistant, l’absence d’hygiène, la peur de la mort et surtout la honte. La honte de ne pas pouvoir élever correctement ses enfants, de ne pas pouvoir leur assurer un avenir, de ne pas être aussi savant est présente dans le récit. La narration est originale avec un mélange de voix le père et la mère se répondent, comme s’ils ne formaient qu’une seule personne, un corps, uni malgré la misère, les compromissions. On se perd au départ dans cette narration, mais peu à peu, on ne cherche plus à savoir qui parle mais on se laisse bercer par la voix. Cette voix qui décrit un pays réduit à des systèmes d’entraide, de débrouille, où on ferme les yeux sur la prostitution, l’exploitation des filles pour assurer le lendemain. Le destin de Babette, la fille ainée du couple que je vous laisse découvrir est d’ailleurs emblématique de cette vie. On se pose alors la question jusqu’où faut il aller pour survivre ? Comment des personnes peuvent être mises à mal, se déshumaniser à ce point là ? Il y a des passages dur mais paradoxalement ce qui lie les personnages c’est le fait qu’ils sont une famille. J’ai apprécié les descriptions, cette vision réaliste, sans concession, les interrogations des parents sur leurs actes. La fin qui dévie vers autre chose, une réflexion à une plus large échelle sur la violence acceptée à Haïti. Loin d’être donneur de leçon, l’auteur nous plonge dans cette famille et nous met à leur place, il réussit à nous dépayser et à nous embarquer dans ce voyage. Malgré quelques longueurs parfois, on ne peut pas lâcher ce roman car on se demande ce qu’il va arriver aux personnages, jusqu’où ils vont aller ? Alors laissez vous prendre par ces voix multiples qui conte la vie à Haïti, comprenez pourquoi les haïtiens sont des brasseurs de la ville et le destin tragique de cette famille qui ne veut qu’une seule chose : survivre. Retrouvez Eirenamg sur son blog
nuit blanche
Les brasseurs de la ville… remuent Port-au-Prince
«Tout ici est question de couleur. Dis-moi quelle couleur tu portes et je te dirai qui tu es. Comme moi les SDF tout couleur vont et viennent ici et là, brassant l’air de la ville.» Dans ce roman bariolé, SDF signifie «Sans destination fixe» et les brasseurs n’ont rien à voir avec la bière, mais désignent ces milliers de gens qui s’agitent dans la capitale haïtienne. «On n’explique pas Port-au-Prince. On vit Port-au-Prince (…) Pour moi Port-au-Prince est un cri de douleur. L’accouchement de la vie y est un film d’horreur où les acteurs croient que tout est normal.» La ville vit à l’heure du brassage et la plupart des gens sont arcs-en-ciel. Comme les narrateurs qui d’emblée donnent le ton d’un livre d’une énergie folle. Parce qu’«à Port-au-Prince, c’est chaque jour le carnaval». Du coup, on ne sait jamais vraiment si on a affaire à une homme ou a une femme. Comme quand Evains Wêche fait tour à tour parler le mari et la femme, sans prévenir le lecteur. Ce qui donne au récit de nouvelles couleurs. Sauf que, comme au cinéma, le tout va finir par un fondu au noir. Mais n’anticipons pas. Si la population de Port-au-Prince, tous ces brasseurs, se démène autant, c’est d’abord pour survivre. La narratrice rêve de se mettre à son compte et d’ouvrir son atelier de couture. «En attendant de quoi m’acheter une machine à coudre, je me débrouille dans la rue.» On ne va pas tarder à comprendre ce que la rue lui offre comme revenu. Le narrateur, quant à lui, malaxe le béton, en rêvant lui aussi, par exemple à un beau mariage. «Je t’aime, mon amour. Je sens mon cœur grand comme ça et mes moyens tandis que mes moyens ne sont qu’un poing contre la vie dure. Elle est coriace, la vie, et elle fait mal.» Surtout quand on soutient d’une famille nombreuse : Lizzie, Yvon, Jonathan, Babette et Acélhomme, en les comptant du plus petit au plus grand. Comme son épouse, il ne cesse de se poser des questions : «Que vont-ils devenir ? Qu’ai-je à leur offrir ? Je suis une pauvre malheureuse. Je n’ai rien. Même pas une patrie. Mes enfants pousseront ici comme la mauvaise herbe dans les champs. Leur avenir est tout tracé. Rien à l’horizon que ce qu’on est, ce qu’on aura réussi à faire de nous.» Babette est une belle adolescente qui ne va pas tarder à attirer les convoitises. Ses parents aimeraient bien lui voir trouver un bon parti. Mais ce «diaspora» qu’elle croise, ce riche M. Eriksson – Américain de passage pour quelques temps dans le pays – a beau lui promettre monts et merveilles, la sortir de son bidonville, la couvrir de cadeaux, elle finira comme sa pute. Lizzie est malade. Sa mère doit alors culpabiliser à chaque visite chez le médecin : «Votre enfant fait à peine le poids d’un bébé pour ses six ans! Vous ne lui donnez pas à manger ?» L’éducation des garçons peut quant à elle se résumer à : «apprenez à vous débrouiller par vous-mêmes, car à Port-au-Prince on ne réussit à survivre que de cette manière. Il est par exemple, illusoire de vouloir trouver du travail. Dans ce pauvre pays, on ne peut que connaître quelqu’un qui connaît quelqu’un qui peut vous donner un travail. Du coup, le carnaval et les images bariolées se transforment en cortège funèbre. Sans dévoiler la dernière partie du roman, disons que le drame pressenti finira bien par arriver et que le noir viendra recouvrir le bel arc-en-ciel. Evains Wêche sait fort bien dire les choses, les décrire. Et si besoin est, à inventer les mots qui manquent pour se rapprocher de la réalité d’Haïti. C’est ainsi qu’il crée le verbe putaniser. Car si «le sexe est la voie la plus sûre pour quitter ce foutu pays», alors il faut se putaniser. Mais ce qu’il en coûte va éclater comme un fruit trop mûr entraînant le lecteur dans une salsa du démon. Retrouvez henri Charles Dahlem sur son blog |
|
|
|
|
|