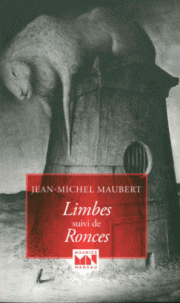|
Les internautes l'ont lu
Effacement…
Estragon. – Où irons-nous ? Vladimir. – Pas loin. Estragon. – Si, si, allons-nous-en loin d’ici ! Vladimir. – On ne peut pas. Estragon. – Pourquoi ? Vladimir. – Il faut revenir demain. Samuel Beckett En attendant Godot J’ai lu Limbes à haute voix afin d’en goûter toute la poésie, la musique, la profondeur, afin de me laisser aller à l’envoûtement des mots, de ces visions de fin du monde sous une lune grise. Un paysage rouille sang peuplé de cadavres d’animaux, d’arbres brûlés et d’ombres d’hommes errants sans fin. Monde halluciné, hypnotique, hanté. Une coulée d’images, de tableaux fascinants et angoissés qui saisissent et envoûtent pour longtemps… Ils sont trois : Lucas vient de mourir, Mona a disparu, le narrateur Samuel ira de terrains vagues en terres désolées, traversant des espaces labyrinthiques infinis, des espaces ravagés où quelques êtres fantomatiques finissent leur pauvre existence. Là, meurent lentement les arbres et les chevaux que personne ne vient achever, créatures abandonnées à une souffrance infinie. Que s’est-il passé ? Qu’a fait l’homme pour en arriver là ? Tout est chaos, déchets industriels, métal calciné, herbe malade. L’eau noire et épaisse sent mauvais. Il ne reste plus rien au narrateur que quelques souvenirs d’enfance auxquels il s’accroche : « Ainsi nous avons grandi, telles des fleurs malades, dans le matin rouge et gris du quartier des abattoirs. ». Mona n’aimait déjà « que les machines et les choses cassées. » Elle avait tué le petit chien en voulant trafiquer son corps. Le grand-père de Lucas, boucher de profession, était devenu fou à force de dépecer et de couper en morceaux des bêtes, des chevaux notamment. La vie s’est lentement transformée en cauchemar. « Mon sommeil est comme la vase des marais. Aucune fuite possible, une fois que tu t’es fait piéger. Tu t’enfonces toujours davantage. » On ne peut que s’enfuir, tenter de s’échapper. En vain. « Je voulais disparaître. Comme une ombre maigre, j’ai traversé des chantiers à l’abandon, des bidonvilles, des décharges publiques… Je me souviens des arbres nus comme de longs fils noirs lacérant le ciel. » Que s’est-il passé ? Des centrales, il ne reste que les radiations qui finissent de tout détruire. Des abattoirs, ne survivent que quelques bêtes mourantes et des hommes devenus fous. Les grilles du zoo ont rouillé et les bêtes vont çà et là dans les hangars, les tunnels, la terre cancéreuse… « Elles rôdaient dans les terrains vagues, vers la zone des marais, avaient trouvé refuge dans les vieilles usines en ruines, envahies de ronces, de broussailles, d’arbres arthritiques, tous plus tordus les uns que les autres. » Le grand-père de Lucas voyant un jour un cheval maltraité l’avait enlacé. Il ne voulait plus le lâcher… Quel fou ont pensé les autres…. Les corps pourrissent lentement, se décomposent : « Certains d’entre nous partent en lambeaux. Nous nous confondons alors peu à peu avec le sable, la boue. » Effacement… Je pense à Kafka, Thomas Bernhard, Samuel Beckett dans l’évocation de cette déchéance physique, de cette disparition progressive des corps dans un monde sans repères spatio-temporels où tout est ruine et décomposition. Seule la voix semble vivante, encore n’est-elle plus qu’un murmure, une invitation au sommeil ou à la mort… ….. Il est des larmes dans le monde Comme si le bon dieu était mort Et l’ombre de plomb qui tombe Pèse le poids du tombeau Georg Trakl La narratrice de Ronces est Grete – Margarethe – la sœur de Georg Trakl, grand poète du début du XXe siècle (1887- 1914), appelé le Rimbaud autrichien, qui se suicida à l’âge de vingt-sept ans. Pharmacien, il sera mobilisé lors de la première guerre mondiale et ne se remettra jamais de ce qu’il verra. Sa poésie angoissée se fait l’écho de ses visions d’horreur : tout est pourrissement, déclin progressif. Les lieux sont indéterminés et sombres, la culpabilité de sa relation incestueuse avec sa sœur revient de façon obsessionnelle, le mal est lancinant. Ronces exprime la souffrance absolue du poète qui se disait « moitié né » : « nous sommes là, nous autres – petites séquences de viande en mouvement, pris dans ce lourd et lent cheminement… un si lourd et lent cheminement – cheminement de bêtes, de pâles choses humaines au teint de nacre, de maladie… » Correspondances de motifs obsessionnels qui traversent, tels des fantômes éteints, de vagues lueurs diaphanes, ces deux textes d’une grande force, poèmes hypnotiques aux images obsédantes et terribles. Un univers hanté, apocalyptique, dans lequel, là, quelque part, plus loin encore, une main tue par amour, sort des ronces des êtres mourants, étouffe la douleur, en silence… Fascinant. Retrouvez Lucia lilas sur son blog |
|
|
|
|
|