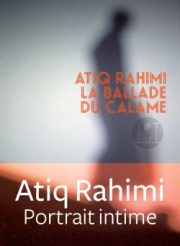« La langue crée le lien
entre l’exil et moi »
Le calame est un stylet, confectionné à partir d’une tige de roseau patiemment taillée. Les enfants afghans l’utilisent pour écrire sur leurs ardoises, en le trempant dans de la craie liquide.
Un jour, Sophie de Sivry, directrice des éditions de L’Iconoclaste, a demandé à Atiq Rahimi d’écrire une autobiographique, plus précisément d’écrire sur son expérience de l’exil. Alors qu’il ne savait pas comment débuter ce livre, plongé dans le désarroi, l’auteur de Syngué sabour emplissait sa feuille de dessins, d’arabesques, de calligraphies. En traçant un « alef », la lettre « a » de l’alphabet arabe, Atiq Rahimi a retrouvé la sensation physique de l’apprentissage de l’écriture, et a ouvert une porte vers lui-même. Ainsi ce nouveau livre s’est-il construit, en forme de portrait intime, fait de souvenirs et d’interrogations. Il revient sur son enfance, explore les secrets de l’alphabet arabe et de la langue persane, réfléchit à la place de l’écriture dans les religions du livre, parle des différentes civilisations qui ont fondé son pays natal. De recherches en recherches, d’énigmes en découvertes, de contes en légendes, Atiq Rahimi nous emporte dans son univers, glissant au fil des pages des mots calligraphiés et surtout des « callimorphies », terme qu’il a inventé pour désigner les étranges dessins à l’encre qu’il signe, dessins de corps à peine ébauchés, nés de la forme d’une lettre, croisement entre la calligraphie arabe, chinoise, et l’art occidental.
Atiq Rahimi part ainsi à la recherche de ce qui l’a constitué. Réfléchir sur la place sacrée de l’écriture dans la civilisation arabo-musulmane le conduit à parler de l’importance de l’écriture en lui. Le livre avance comme un jeu de piste, un chemin plein de méandres, jalonné de quelques événements qui ont marqué son existence. L’arrestation de son père en 1973, son départ pour l’Inde en 1978, pour la France dans les années 80 et son retour en 2002 à Kaboul.
Cette déambulation fait naître un texte littéraire très libre, poétique et émouvant, où reviennent sans cesse le thème de l’exil, mais aussi l’« alef », cette lettre qui ouvre l’alphabet, l’Afghanistan et le prénom Atiq.
Vous commencez votre livre, Atiq Rahimi, sur la difficulté que vous avez à l’écrire.
C’est toujours mon problème : dès que je me mets à écrire j’ai l’impression que je n’y arriverai jamais, d’autant plus pour ce livre. Depuis deux ans, je tentais de venir à bout de l’ouvrage que m’avait demandé Sophie de Sivry. J’avais écrit des pages et des pages mais le livre n’était toujours pas là. Entretemps j’avais achevé un projet de film, qui montrait l’errance d’un jeune Afghan exilé dans Paris. Trois semaines avant le tournage on a tout arrêté, pour un problème de financement entre autres. Je me suis enfermé dans l’appartement qu’on avait loué pour l’acteur principal pendant deux mois et j’ai écrit La ballade du calame. Justement pour raconter cette angoisse devant la feuille blanche, cette incertitude, et le rapport qui existe entre exil et création.
C’est le calame qui vous permet d’attraper le fil du livre.
En Afghanistan, durant les premières années à l’école nous devions apprendre l’écriture par la calligraphie. Il fallait utiliser des tablettes noires, de la craie liquide et un calame. C’est un apprentissage assez difficile à cet âge-là, il n’est déjà pas évident de tailler un roseau et là bas, les professeurs sont trop exigeants, on recevait pas mal de coups de règle sur le bout des doigts. Tous ces souvenirs qui étaient restés en moi ont surgi d’un seul coup, alors que je voulais écrire sur l’exil, que je n’y arrivais pas et que ma main se baladait sur le papier avec une plume, je traçais des lettres et ces lettres me renvoyaient à mon enfance. L’alef, la première lettre de notre alphabet a été une sorte de madeleine de Proust. Mon enfance m’a ramené à ma mère, mon père, et à mon rapport à la religion, car la calligraphie chez nous est très liée aux textes sacrés. Elle est même née des textes sacrés pour les textes sacrés.
Vous racontez que la forme même des lettres est sacrée.
Je suis en effet le produit d’une culture, d’une civilisation, d’une pensée où les lettres ont une importance ésotérique. Je raconte comment ma mère et ma grand-mère confectionnaient des talismans à partir de versets du coran. J’ai toujours été fasciné par cette importance des lettres et des textes dans notre vie et dans notre manière d’être. Aussi, quoi que je fasse, et parce que j’appartiens à cette culture, les lettres ont cette importance pour moi, même si je ne suis pas croyant. Ma pensée a été structurée avec ces textes-là.
On vous voit travailler comme un chercheur pour établir des liens entre les trois religions et entre les différentes cultures qui ont façonné l’Afghanistan. Du coup, le livre se transforme en un jeu de piste où chaque recherche en emmène une autre.
Mon enfance m’a emmené à la calligraphie, qui m’a emmené vers l’islam, qui m’a emmené vers d’autres religions, puis à mon voyage en Inde, puis à l’influence de l’Inde dans ma pensée, etc… Je me suis laissé porter. Je ne cherchais pas une structure, c’est une sorte de balade et c’est la première fois que j’écris comme ça. L’alef devient à la fois un personnage et la métaphore de cette enfance perdue. Et j’en arrive à une sorte de méditation sur l’écriture et sur mon exil.
Mais vous ne nous racontez toujours pas précisément l’exil. Vous ne parlez pas de ce qui s’est passé dans les mois qui ont suivi votre départ d’Afghanistan, par exemple.
Plus important à mes yeux est ce rapport entre exil et création. Les témoignages d’émigrés et de réfugiés, il en existe déjà. Si on regarde bien, nous avons tous vécu la même chose, quand je les lis j’ai l’impression qu’il s’agit de ma vie. Je ne voulais pas en écrire un de plus, et je ne voulais pas d’un texte disant : « Regardez à quel point j’ai souffert en tant qu’exilé ». Je ne voulais pas d’une lamentation autour du thème de l’exil mais plutôt : qu’est-ce que l’exil m’a apporté ? Voilà : montrer l’importance de l’exil chez l’être humain. Et je ne voulais pas raconter ma vie intime. Je ne suis pas quelqu’un qui s’expose facilement, et c’est encore un phénomène culturel : l’idividualité n’existe pas dans ma culture d’origine. J’ai donc une certaine pudeur par rapport à ma vie personnelle, et puis, je vous avoue : quel intérêt ? Je raconte l’arrestation de mon père, qui a été un événement très important pour moi, la mort de mon frère, et je parle de la création. Le reste, comment je suis arrivé en France, mes impressions d’être étranger en France, tout cela n’a aucun intérêt. Et puis peut-être qu’au fond de moi je suis un être abominable, minable, et que je ne veux pas que les autres me connaissent.
Vous dites que, ce qui caractérise l’art arabo-musulman, c’est l’entrelacement. Cela caractérise aussi votre vie. Un entrelacement de plusieurs cultures et plusieurs formes artistiques puisque vous êtes écrivain, cinéaste et callimorphe.
Je suis un personnage tissé et métissé de différentes cultures et différents arts. Parce que je suis toujours à la recherche de quelque chose. De quoi, je ne sais pas.
Que vous apporte de passer d’une forme artistique à une autre ?
Chaque art révèle une dimension particulière d’une réalité, d’un sujet, d’un être humain. J’essaie toujours de voir comment quelque chose peut être raconté dans un roman, ce que les mots révèlent. Mais qu’est ce que le cinéma peut révéler d’une histoire que j’ai déjà racontée ? Qu’est-ce que la calligraphie révèle d’un mot ? Et quelle relation entre les mots et le corps humain ? C’est ainsi que la callimorphie est née. Le corps révèle les lettres et les lettres révèlent le corps. Je recherche cette dimension cachée que chaque art s’approprie et révèle.
La callimorphie, ce sont des corps nés de la calligraphie, des mots. Cela renvoie à Syngué sabour, roman qui vous a valu le Goncourt et que vous avez ensuite adapté au cinéma : une femme prend la parole et prend alors conscience de son corps.
Oui, et pour moi c’est découvrir ce qui est invisible, dans un événement ou dans un être. Pas invisible dans un sens religieux, mais le passé par exemple est invisible. L’art est là pour révéler ce qui est invisible mais existe au fond de moi. J’avais besoin de réfléchir à tout ça, et réfléchir au fait que je n’arrive toujours pas à faire un livre sur l’exil. Au lieu d’écrire, je dessinais des callimorphies, pourquoi ? Pourquoi le thème de l’exil m’a-t-il poussé vers le roseau, l’encre de chine, le corps. Un fil nous guide, je ne sais pas où il nous conduit, mais ce qui est important c’est ce qu’on découvre en écrivant.
Mais pourquoi, au fond, la callimorphie permet-elle de dire ce que vous ne pouvez dire en écrivant ?
Parce que cela raconte le désir et l’absence. Ce corps dans le vide de la page blanche est le corps en exil. Le livre je pense est le pendant de mon troisième livre, Le retour imaginaire, qui parlait de mon retour à Kaboul.
Le retour à Kaboul en 2002 a signifié pour vous l’abandon du persan, puisqu’ensuite vous avez écrit Syngué sabour en français. Les callimorphies ne sont elles pas un moyen de vous réapproprier votre langue ?
Je n’y avais pas pensé, mais maintenant que vous le dites. C’est un retour à ma langue maternelle, un retour à mes origines que je ne peux faire physiquement, pourtant pour décrire l’exil je suis obligé de retourner d’où je viens. Et la langue crée le lien entre la terre d’origine et moi, entre l’exil et moi. Ainsi, je ne peux séparer ma création ni de mon exil ni de mon enfance.
Propos recueillis par Sylvie Tanette