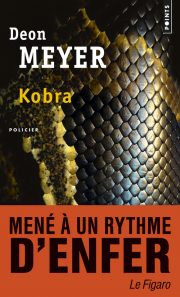« Cela me terrifie de faire perdre son temps au lecteur »
Ses romans se déroulent au Cap, où il vit. Ils montrent que tout n’est pas limpide au sein de la Nation Arc-en-Ciel chère à Nelson Mandela. Ils mettent en scène des policiers noirs, blancs et métis soudés face à la corruption du régime et aux maux de la société sud-africaine : inégalité, criminalité, violence… Pourtant, Deon Meyer n’a rien d’un écrivain exotique. C’est un conteur dont le talent et les histoires ignorent les frontières.
Son neuvième roman, « Kobra », est une course folle contre le temps et la mort, dans la lignée des récents « 13 heures » et « A la trace ». Côté proies, un jeune pickpocket qui a glissé les doigts dans le mauvais sac et un super-crack british de l’informatique qui a forcé les mauvais comptes bancaires. Côté chasseurs, un mystérieux commando de tueurs étrangers. Entre les deux, le capitaine Benny Griessel, alcoolique, amoureux, malheureux, et ses équipiers de la Criminelle.
Cette double traque à perdre haleine combine poursuites, filatures et écoutes téléphoniques. Le lecteur y cherche parfois son souffle, l’auteur jamais. Le récit est chronométré, millimétré, rythmé comme une épreuve d’obstacles. Pas une seconde il n’en perd le fil, s’appuyant sur un casting tout en finesse. Chaque protagoniste est à sa place, fortement typé, facile à cerner sans même qu’il ait à le décrire.
Une mécanique efficace, puissante, comme celle des motos que le romancier aimait enfourcher pour aller se ressourcer sur les routes du bush. C’était avant qu’il ait du succès. Deon Meyer, qui écrit en afrikaans, est aujourd’hui traduit dans une trentaine de langues. Il voyage beaucoup pour assurer le lancement de ses livres. Cette semaine, avant d’aller à la rencontre de ses lecteurs autrichiens et allemands, il faisait halte en France : six villes en neuf jours, dont Paris. C’est là qu’onlalu l’a rencontré.
« Kobra » est sur une course contre le temps, comme deux autres de vos romans. Pourquoi aimez-vous tant cette mécanique ?
Cela donne un élan à l’histoire, un rythme, qui permettent d’accrocher le lecteur. Sur 400 pages, je ne veux surtout pas perdre son attention en route, je veux qu’il reste impliqué. Dans ma jeunesse, j’aimais déjà ce genre de livre où tout va très vite, où l’on est pressé de savoir ce qui se passe au chapitre suivant.
Vos romans sont « à 0% de matière grasse » : peu de description, des dialogues directs, de l’action… Comment parvenez-vous à cette efficacité ?
C’est comme cela que j’écris. Ce que vous lisez au final est très proche de mon premier manuscrit, je fais très peu de coupes. Je pars du principe que si une scène ou un paragraphe ne contribue pas à faire avancer l’histoire, il ne doit pas y figurer. Cela me terrifie de faire perdre son temps au lecteur.
Vous partez d’un canevas très précis ?
Non, absolument pas. Mon ami Mike Nichol (1) a une excellente image qui décrit ma façon de travailler : c’est comme conduire de nuit, en sachant grosso modo vers où vous allez, mais en ne voyant que la portion de route éclairée par vos phares. Quand j’écris, j’ai une idée de fin, et je me concentre juste sur le chapitre suivant. L’inspiration, selon moi, est quelque chose de pragmatique : je résous des problèmes pour conduire un personnage d’un point A à un point B.
Vos romans sont très visuels. Vous faites beaucoup de repérages ?
Je vais sur le terrain pour mémoriser des impressions. J’intériorise l’atmosphère, afin de savoir ce que ressentent mes personnages au même endroit. Pour « Kobra », j’ai passé du temps à la gare de Bellville et dans les trains, pour m’imprégner du décor dans lequel évolue Tyrone Kleinbooi, le jeune pickpocket. Pour écrire la scène de l’échange, il fallait que j’aille sur place pour savoir comment il pouvait procéder. J’y ai pris beaucoup de photos – dont certaines visibles sur mon site – pour vérifier sous quel angle on pouvait surveiller ses agissements. J’ai observé les gens qui passent, leur manière de bouger, enregistré les couleurs, les bruits, les odeurs. Je me constitue une banque de sensations dans laquelle je puise au moment d’écrire.
Comment faites-vous pour typer à ce point vos personnages ?
Je réfléchis beaucoup à chacun d’eux. Tout le temps, en fait. J’ai en tête ce à quoi ils ressemblent, le parcours qu’ils ont suivi… Mais je ne fais pas de fiches. Je ne veux rien figer de définitif, juste apprendre à les connaître en avançant, comme une relation qui se construit. Je veux que mes personnages soient aussi complexes et aussi peu prévisibles que les vrais gens.
Dans « Kobra », une vraie complicité se noue dans l’équipe des policiers, avec des sous-entendus, de l’ironie…
Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, je passe beaucoup de temps avec de vrais policiers à les écouter, les observer dans leur travail. Et c’est une réalité : plus ils ont sont sous pression, plus ils sont proches les uns des autres. Ensuite, à mesure que je vieillis, je m’autorise sans doute à regarder le monde avec davantage de douceur, d’humour, d’indulgence. Nous, les humains, sommes des animaux trop sérieux. Enfin, quand le suspense est particulièrement dramatique, l’humour me permet de le faire retomber pour mieux le relancer ensuite.
Pourquoi le problème d’alcool de votre héros, Benny Griessel, prend-il une telle place ?
A l’origine, dans mon premier roman, « Jusqu’au dernier », le personnage principal était Matt Joubert, un flic très sombre et dépressif. J’avais besoin d’un effet comique pour compenser : j’ai créé Benny juste pour faire rebondir quelques scènes. Et puis je me suis mis à l’apprécier, j’ai senti qu’il avait du potentiel. J’ai voulu en faire le héros du livre suivant, « Le pic du diable », mais en dépassant le cliché du flic alcoolique. Alors j’ai cherché pourquoi il buvait et sur quels ressorts sa maladie pouvait jouer. Je me suis documenté auprès de médecins, de psys, de vrais flics alcooliques, je suis allé à des réunions d’alcooliques anonymes. Benny a besoin de boire pour supporter le stress post-traumatique et il lutte en permanence. Il sera toujours malheureux. Mais après tout, un flic heureux ne ferait pas un héros très intéressant…
A côté de vos romans, vous venez de publier un guide du « hors-piste » à l’intention des motards sud-africains…
En fait, c’est un ami photographe et motard qui m’a sollicité : nous avons mis en commun ses images et des chroniques que j’avais écrites pour un magazine spécialisé. Je me suis bien amusé. La tournée de promotion m’a fait rencontrer un public différent. Les motards sont des gens très bien.
Vous faites toujours de longues balades à moto dans la nature sud-africaine ?
Je n’ai plus le temps. Je me lève le matin vers 4 ou 5 heures pour écrire, et l’après-midi, je me consacre à la société de production de films que j’ai montée avec un associé. Nous avons déjà sorti cinq films. J’ai écrit trois des scénarios, je supervise les autres scénaristes et j’assure la production exécutive. J’ai besoin d’être toujours très occupé, sinon je suis de mauvaise humeur…
Propos recueillis par Philippe Lemaire
(1) Mike Nicol, journaliste et romancier du Cap, auteur de « La dette », éditions Ombres Noires
Lire les autres rencontres de o n l a l u