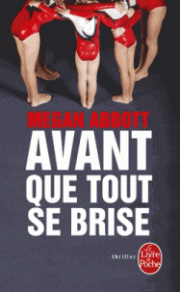i n t e r v i e w
« Le roman noir n’a pas assez exploré
le mystère de la victime mâle »
Une ado surdouée en gymnastique, des parents qui rêvent de médaille olympique, une banlieue arrimée à sa championne. Une communauté prête à tout pour sortir de l’ombre… Dans « Avant que tout se brise », son huitième roman, Megan Abbott s’immerge dans une Amérique moyenne à la fois paisible et perturbée. Un ancrage réaliste amorcé depuis trois livres, après ses premiers exercices de style (« Adieu Gloria », « Red Room Lounge »), où elle revisitait une culture de jeunesse nourrie de films noir et de pulp fictions. Mais un réalisme qu’elle porte à son point d’incandescence dans cet intense suspense psychologique. Comme si, à 45 ans, cette New Yorkaise d’adoption ouvrait en grand ses fenêtres sur le vrai monde. La voici cousine d’une Gillian Flynn (« Gone girl »), d’une Wendy Walker (« Tout n’est pas perdu ») ou d’une Paula Hawkins (La fille du train »), toutes attachées à soulever les tapis sous lesquels croupissent les secrets inavouables des classes moyennes. Ici, il s’agit de savoir qui a renversé et tué, un soir, sur une route, le beau gosse du club de gym, cible de bien des désirs et des jalousies. Inspirée, Megan Abbott développe l’intrigue du point de vue d’une mère de famille, condensé de toutes les angoisses. Elle devient un auteur plus accessible, sans atténuer le parfum vénéneux qu’exhale sa galerie de mères frustrées et de séductrices post-pubères. De quoi lui valoir enfin, neuf ans après la reconnaissance de ses pairs (un prix Edgar Allan Poe, l’Oscar du polar), celle d’un plus large public ?
Qu’est-ce que ce roman a de différent des précédents
Megan Abbott. Le sujet est plus large que dans un roman noir traditionnel. Je traite des interactions entre un individu, sa famille et leur communauté. J’ai toujours été interessée par les systèmes fermés, les mondes dans un monde. Dans d’autres livres, c’est la mafia. Ici, c’est une banlieue américaine moyenne.
Vos derniers romans sont centrés sur des personnages d’adolescentes « dures ». Pourquoi cette fascination pour cet âge ?
C’est une période, surtout chez les filles, où se décide ce que vous allez devenir. Elles sont guidées par des sentiments immédiats, impulsifs, purs, de l’ordre de l’instinct, avant de trouver leur place dans la société. A cet âge, elles affichent un masque sous lequel personne ne peut lire. C’est l’âge des expériences, des tournants et des désillusions. Et cela accroche le lecteur, comme si on lui murmurait à l’oreille : on a tous fait ça, on a tous eu ces moments…
Dans « Vilaines filles », elles étaient pom-pom girls. Ici, gymnastes. Pourquoi pas musiciennes ou peintres ?
C’est un âge où le corps et son contrôle importent beaucoup. C’est une façon de parler de l’intimité.
Comment vous-êtes vous impregnée de cet univers sportif ?
Des gens qui connaissaient m’ont raconté les bruits, les odeurs, la vitesse, le poids… J’ai aussi beaucoup lu, il y a d’excellents récits de souvenirs. Le plus fort pour moi est celui de la Roumaine Nadia Comaneci : c’est un grand livre, une histoire folle, extrême. La gymnastique était tout ce qu’elle possédait, ça l’a sauvée. Elle ne souriait jamais, les journalistes voulaient voir en elle une femme fatale… J’ai suivi également l’Américaine Ali Raisman, médaillée aux JO de Londres : une guerrière, mais réfléchie, intense. Et il y a cette vidéo, à la fois drôle et effrayante, où ses parents assis dans les gradins reproduisent inconsciemment chacun de ses mouvements. Souvent, c’est un seul des parents qui se surinvestit dans l’activité de l’enfant, généralement la mère. Ce qui m’a intrigué chez eux, et inspirée, c’est qu’ils agissaient en couple, comme si toute la famille était impliquée dans les performances d’Ali. Je me suis demandée quel genre de mariage c’était, si c’était bien un mariage ou pas. Dans mon livre, les parents de Devon ne savent pas trop s’ils existent pour eux-mêmes ou pour leur fille : est-ce qu’au fond, ils ne se sont pas mariés juste pour lui donner naissance ?
Vous connaissez ce genre de parents ?
Aux Etats-Unis , cela devient énorme. On les appelle des « parents hélicoptères » (ndlr. car ils planent au dessus de leur enfant), la réussite les obsède, leurs petits commencent à 4 ans. Quand j’étais enfant, on avait le temps de s’ennuyer et d’explorer pour se construire. On a perdu de cette simplicité, de cette innocence. Aujourd’hui, les enfants sont gavés de sollicitations, notamment électroniques.
Vous avez suivi les J.O de Rio, les médailles de Simone Biles ?
Oui, j’étais en pleine tournée aux Etats-Unis pour la sortie de ce livre et toute le monde me tweetait des messages sur elle. Il y avait une dynamique intéressante chez les Américaines : on sentait de l’agressivité entre elles, comme entre des gladiateurs. C’était une une équipe dans un sport individuel, on leur demandait l’impossible.
Pourquoi faut-il que, dans vos romans, ce soit toujours un homme qui soit tué ?
Il y a tant de romanciers ou de cinéastes chez qui les femmes meurent par la faute des hommes ! J’ai bien dû tuer un personnage féminin ou deux, mais le roman noir n’a pas assez exploré le mystère de la victime mâle, la relation d’une femme à sa victime… Dans mon prochain livre, dont j’ai écrit la moitié, c’est encore un homme qui est tué. Je me suis inspirée des « Diaboliques », le film de Clouzot avec Simone Signoret. C’est une combinaison fascinante, deux femmes alliées pour éliminer un homme…
Dans « Avant que tout se brise », vous montrez la noirceur cachée dans des existences ordinaires, un peu comme l’a fait Gillian Flynn dans « Gone Girl »…
Ce qui nous rapproche, c’est un intérêt pour la peur primale. Et elle est plus présente chez la femme, la mère, qui redoute l’irruption de la violence dans son foyer. Il y a toujours eu des fictions sur ce thème, mais elles sont plus visibles aujourd’hui, plus facilement publiées. « Gone Girl » a désormais la permission d’exister au même titre que les mystères domestiques de Mary Higgins Clark – que j’ai par ailleurs dévorés. L’Amérique s’interroge sur la femme violente, se cherche des héroïnes qu’on peut ne pas aimer. C’est aussi parce que des femmes fortes disent ce qu’elles pensent, font voler des portes en éclats, de Hillary à Beyoncé, chacune à sa manière.
A l’époque de « Adieu Gloria », en 2011, vous aviez gardé un travail salarié. C’est toujours le cas ?
Oh là, non, j’ai dû arrêter ! Comme j’ai vendu les droits de « Vilaines filles » et de « Fièvre » pour la télé, j’ai eu besoin de temps pour écrire les adaptations. J’ai aussi écrit un scénario pour Hollywood et puis j’ai été recrutée par David Simon, le créateur de « The Wire » et « Treme », pour intégrer l’équipe de scénaristes de sa nouvelle série, « The Deuce ». On est huit enfermés dans une salle six heures par jour à discuter, à écrire des notes. C’est excitant et intense. On parle tous la même langue. David Simon adore ces échanges, il a beaucoup d’énergie à partager. Je crois qu’au fond, il aime faire travailler des romanciers parce qu’on ne va pas essayer d’aller racoler ailleurs.
Vous vivez toujours à New York ?
Je n’imagine pas vivre ailleurs. C’est là où est mon éditeur, là où se tourne « The Deuce ». Mais je sais aussi que je peux y trouver tous les films, tous les livres et toutes les événements artistiques possibles, j’ai besoin de cette énergie, besoin de cette stimulation permanente.
Propos recueillis par Philippe Lemaire